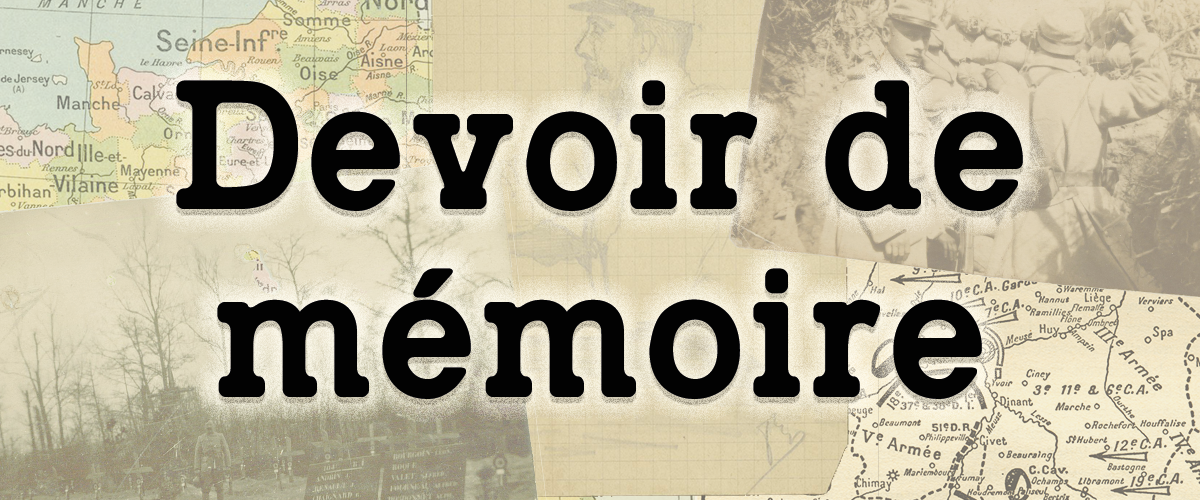Fiche d’identité
Naissance : 12 avril 1888, Saint-Étienne-du-Rouvray.
Décès : 23 mai 1916 (28 ans), Douaumont (55).
Profession : employé de tissage.
Grade : soldat, 74e Régiment d’Infanterie, classe 1908.
Campagne contre l’Allemagne : 3 août 1914 au 23 mai 1916 (1 an et 9 mois).
À quoi ressemblait-il ?
Louis Dessaint mesurait 1m71. Il avait le crâne rasé et les yeux bleus. Il était tatoué aux deux bras.
Il avait le niveau d’instruction 2, ce qui signifie qu’il savait lire et écrire, mais n’avait probablement jamais terminé son cursus scolaire.
Il était marié à Marie Burel et vivait au 58 rue des Fossés Louis VIII à Rouen.
Biographie
Marcel Joseph Lebrun naît le 12 avril 1888 à Saint-Étienne-du-Rouvray, d’une mère célibataire, ouvrière de filature de 22 ans, dont il prendra le nom. À peine âgé de 2 ans, le garçon devient orphelin. Recueilli par sa famille, il grandit dans la commune. En 1909, le jeune homme se présente aux bureaux de l’Armée pour effectuer son service militaire obligatoire. La fiche de renseignements alors complétée nous apprend qu’il habite toujours à Saint-Étienne-du-Rouvray, où il est employé de tissage. Il
travaille probablement à la Société cotonnière, la grande usine de filature de la ville qui emploie près de 2 000 ouvriers au début du XXe siècle.
Lorsque Marcel Lebrun revient à la vie civile, en 1911, il rencontre Marie Burel, une jeune femme originaire de Oissel, qu’il épouse au début de l’année 1913. Il a alors 25 ans. Le couple s’installe sur la rive droite de Rouen, rue Orbe, puis rue des Fossés Louis VIII.
Au début du mois d’août 1914, la guerre éclate. Répondant à l’appel à la mobilisation générale, Marcel Lebrun rejoint le 74e R.I. (Régiment d’Infanterie). Le régiment est cantonné dans la caserne Pélissier, à Rouen. Le 5 août, après quelques jours de préparation, le 74e R.I. défile à pieds dans les rues de la rive gauche de Rouen et rejoint la gare Saint-Sever. La foule, venue le saluer, est en liesse. Les troupes sont acheminées en train jusqu’à la frontière belge, dans les Ardennes. Elles y restent une dizaine de jours, le temps de réaliser des exercices et des manœuvres, et d’inculquer quelques notions pratiques aux soldats fraichement mobilisés. Le 16 août, le 74e R.I. traverse la frontière belge et marche vers Charleroi. Le Journal de Marche et d’Opérations évoque l’approche ennemie : les Allemands, violant la neutralité belge, ont envahi le pays. Le 21 août, deux compagnies du 74e R.I. échangent quelques tirs avec l’ennemi. Mais c’est le 22 août que le tout premier combat a lieu. Le village des Roselies, vidé de ses habitants, est le théâtre de combats de rue d’une extrême violence. Les Allemands, armés de mitrailleuses, sont embusqués dans les maisons désertées et abattent méthodiquement les soldats français. Ce jour-là, près d’un tiers du 74e R.I. est décimé, soit près de 1 100 hommes. Plusieurs Stéphanais tombent à cette occasion (Athanase Massieu et Émile Lepesqueur, âgés de 21 et 22 ans, tous deux au 74e R.I., ainsi que Gaston Notias, du 239e R.I., âgé de 31 ans). Marcel Lebrun, quant à lui, en réchappe. Après ce désastre, l’armée française recule précipitamment. Dans des conditions dantesques, le 74e R.I. bat en retraite.
Au mois de septembre 1914, le régiment prend part à la célèbre bataille de la Marne, qui permet d’arrêter les troupes allemandes avant qu’elles n’atteignent Paris. Par la suite, le 74e R.I. demeure au nord de Reims (51) pendant près de huit mois. Le 25 décembre 1914, le Journal de marche du régiment raconte les fraternisations de Noël.
Restées célèbres, elles voient notamment le 74e R.I. sympathiser, le temps d’une trêve, avec les soldats allemands. Marcel Lebrun et les autres Stéphanais du régiment y assistent certainement.
En mai 1915, le 74e R.I. est envoyé combattre en Artois, dans le nord de la France. Il y passe six mois et compte de nombreuses pertes, notamment parmi nos Stéphanais…
Le 28 mars de l’année suivante, le régiment part pour Verdun, où la célèbre bataille a débuté il y a quelques semaines. Très rapidement, le 74e R.I. se fait remarquer par son efficacité : il reçoit une citation à l’ordre de la IIe Armée. Fin avril, Marcel Lebrun et ses camarades reçoivent l’ordre de reprendre le fort de Douaumont aux Allemands. Les combats sont d’une violence inouïe. Les soldats souffrent. L’Historique régimentaire raconte ceci :
« Un déluge de feu s’abat sur nous, les gaz nous prennent à la gorge, la soif devient un supplice, mais l’eau n’arrive pas : aucune corvée ne peut atteindre la ligne » (Historique régimentaire du 74e R.I., p.16).
Le 23 mai 1916, le régiment est envoyé à l’assaut du fort, sous un bombardement ennemi qui durera jusqu’à la nuit. Les archives racontent que l’artillerie lourde française tire trop court et touche ses propres lignes, occasionnant des pertes supplémentaires au sein du 74e RI. (J.M.O., 26 N 660/13, p.65). Ces mêmes archives recensent précisément les victimes quotidiennes. Le 23 mai, certaines compagnies comptent jusqu’à 104 disparus pour seulement 4 blessés… preuve, s’il en fallait, de l’immense violence des bombardements. La compagnie à laquelle appartient Marcel Lebrun recense, quant à elle, 16 disparus, 6 tués et 15 blessés. Le stéphanais fait partie des victimes, tués par un tir ennemi à l’âge de 28 ans. Au total, le régiment perd 683 hommes ce jour-là, dont 472 sont portés disparus. Dans ces combats dantesques, d’autres Stéphanais tombent à l’ennemi : Paul Maupu (du 36e R.I. et âgé de 27 ans) et Raoul Rocher (du 129e R.I. et âgé de 19 ans) disparaissent la veille du décès de Marcel Lebrun.
La famille de Marcel Lebrun est rapidement prévenue, car il semble que sa veuve, Marie Burel, touche une pension dès le 15 juillet 1916.
Marcel Lebrun assiste aux fraternisations de Noël 1914
« Dans la matinée, un certain nombre d’allemands sont sortis de leurs tranchées sans armes et en levant les bras ; quelques-uns d’entre eux portaient des petits sapins comme arbre de Noël. Quelques-uns de nos hommes voyant cela sont également sortis de leurs tranchées. Dès que ces faits regrettables ont été rapportés au Colonel, il a donné ordre de faire retirer ces hommes et d’ouvrir immédiatement le feu sur les allemands ». Extrait du J.M.O. du 74e R.I., 25 décembre 1914.
Citation posthume au Journal officiel de la République française, 1er septembre 1922 : « Brave soldat. Tombé glorieusement pour la France, le 30 septembre 1915, à Tahure en accomplissant son devoir ».
Sources : fiche matricule, actes de naissance et de décès, registres d’état civil et liste électorale (1913) de Saint-Étienne-du-Rouvray, fiche MdH, Livre d’Or, J.M.O. et Historique régimentaire des 74e R.I.
Autrice : Ariane Biard, professeure d’Histoire-Géographie et Ilyes AMEUR, 3eC, collège Paul Eluard, 2025.